Simplifiez votre compta avec un expert-comptable à vos côtés
Se faire accompagner
🎁 Offre : Assurance contrôle fiscal à 100 € ⏳ J’en profite

Le Blog de Clementine
Guides, conseils et astuces pour piloter votre activité avec sérénité.
Dernière mise à jour le · 8 min

Clore un chantier ne consiste pas seulement à terminer les travaux et à réceptionner l’ouvrage. La véritable fin d’un marché de travaux se joue aussi sur le plan administratif et financier. C’est précisément le rôle du DGD (Décompte Général Définitif) : ce document scelle de manière contractuelle le règlement final entre le maître d’ouvrage et l’entreprise titulaire.
Dans ce guide, nous allons décortiquer ce qu’est le DGD, ce qu’il contient, qui le prépare, à quel moment il intervient et surtout comment éviter les erreurs fréquentes.
Le décompte général définitif ou DGD est un document contractuel obligatoire dans les marchés publics de travaux et fortement recommandé dans les marchés privés. Son objectif est simple : fixer définitivement les droits financiers et obligations de chaque partie à la fin d’un chantier.
Concrètement, il récapitule :
le montant total des prestations réellement exécutées
les acomptes déjà versés
le solde restant dû à l’entreprise
Le DGD a une forte valeur juridique, car une fois signé par l’entreprise, il est considéré comme accepté et ferme définitivement le marché. Cela signifie que toute réclamation ultérieure (par exemple demander un paiement supplémentaire ou contester une pénalité de retard) devient irrecevable si elle n’a pas été inscrite dans le DGD ou signalée avant sa signature.
En ce sens, le DGD joue un rôle similaire à un contrat de clôture : il acte la fin de la relation et garantit que chacune des parties connaît ses droits et obligations finales.
Un DGD ne se limite pas à une simple facture de solde. Il doit comporter plusieurs éléments distincts, permettant de donner une vision exhaustive de la situation financière du marché.
Ce document reprend la totalité des prestations réellement exécutées par l’entreprise. On y retrouve :
le détail des travaux effectués
le montant final correspondant
les éventuelles pénalités appliquées (retard, non-conformité)
les révisions de prix prévues au contrat (par exemple en fonction de l’évolution du coût des matériaux)
L’objectif est de donner une vision claire de la valeur réelle du chantier, corrigée des aléas rencontrés.
Il s’agit du calcul du reste à payer. Le certificat compare le montant final des travaux avec les sommes déjà réglées via les décomptes provisoires.
Exemple :
Montant final des travaux : 150 000 € HT
Acomptes déjà payés : 130 000 €
Solde restant dû : 20 000 €
Ce document permet de sécuriser le paiement final et d’éviter les contestations ultérieures.
Il dresse l’historique des paiements intermédiaires effectués tout au long du chantier. Pour chaque acompte, on doit retrouver :
la date de versement
le montant payé
la référence du décompte intermédiaire
Ce suivi permet d’assurer qu’aucune somme n’a été omise et que le calcul du solde est correct.
L’établissement du décompte général définitif résulte d’une responsabilité partagée entre les différents intervenants du marché.
Le maître d’œuvre, qu’il s’agisse de l’architecte, d’un bureau d’études ou du conducteur de travaux selon la configuration retenue, a pour mission de préparer le projet de décompte.
Ce projet est ensuite transmis au maître d’ouvrage, qui en assure la notification officielle auprès de l’entreprise titulaire.
À partir de cette communication, l’entreprise dispose d’un délai précis pour se prononcer. Elle peut l’accepter, ce qui permet de clore la procédure, ou bien le contester, entraînant alors un échange contradictoire.
La loi et les contrats fixent des délais précis, qui visent à éviter des blocages interminables en fin de chantier.
Après la réception de l’ouvrage, les différents intervenants transmettent leurs documents de clôture, ainsi :
Le maître d’œuvre dispose de 30 jours pour établir le projet de décompte général.
Le maître d’ouvrage a ensuite 30 jours pour le notifier à l’entreprise.
L’entreprise dispose de 30 jours pour signer le document ou émettre des réserves.
Si l’entreprise ne répond pas dans ce délai, le DGD est considéré comme tacitement accepté.
Pour éviter que l’entrepreneur reste bloqué dans l’attente d’une réponse du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, une procédure dite « tacite » a été introduite en 2014. Son objectif est simple : réduire les délais et sécuriser plus rapidement le paiement des sommes dues à l’entreprise.
Lorsque l’entrepreneur transmet au maître d’ouvrage le projet de décompte final (PDF) et si ce dernier ne répond pas dans un délai de 30 jours, l’entrepreneur peut activer la procédure accélérée. Il lui suffit alors de notifier un projet de décompte général qui doit inclure trois éléments essentiels :
le projet de décompte final déjà transmis
le projet d’état de solde
un récapitulatif des acomptes mensuels
À partir de la réception de ce projet, le maître d’œuvre dispose de 10 jours pour établir le DGD.
Si ce délai expire sans retour, le projet notifié par l’entrepreneur acquiert automatiquement la valeur de DGD tacite. En d’autres termes, le silence de la maîtrise d’œuvre vaut validation.
On pourrait croire que le DGD n’est qu’un document administratif de plus. C’est en réalité un document très important du processus de construction, car il a une triple portée :
Juridique : il ferme le contrat. Sans DGD signé, le marché reste ouvert aux contestations.
Financière : il détermine le solde définitif dû à l’entreprise, ce qui évite des litiges sur les paiements.
Contractuelle : il protège les deux parties en fixant une date de clôture claire.
💡 À savoir : selon le Médiateur des entreprises, 25 % à 30 % des dossiers traités en 2023 concernaient des retards de paiement. Un DGD complet et accepté dans les règles permet d’éviter une grande partie de ces litiges.
Le DGD a pour objet de clore définitivement les comptes du marché et, une fois établi, il fait obstacle à toute réclamation ultérieure.
L’absence de réserves ou d’une évaluation de leur coût peut être interprétée comme une renonciation, privant ainsi le maître d’ouvrage de la possibilité de solliciter réparation ou de retenir les sommes nécessaires à la levée des désordres constatés.
Leur inscription dans le DGD constitue donc une garantie indispensable pour la préservation des droits des parties et pour assurer une clôture juridiquement sécurisée du marché.
Que se passe-t-il si le DGD est mal rédigé, incomplet… ou même non signé ?
Un DGD qui comporte des erreurs ou des oublis peut avoir certaines conséquences :
Omission de postes importants : travaux supplémentaires, révisions de prix ou avenants non mentionnés équivalent à une perte sèche pour l’entreprise, qui ne pourra plus réclamer ces sommes par la suite.
Mauvais chiffrage : une simple erreur de calcul peut déclencher des contestations du maître d’ouvrage ou prolonger inutilement la procédure.
Absence de réserves : si les réserves émises lors de la réception ne figurent pas dans le DGD, le maître d’ouvrage peut perdre la possibilité de les faire valoir ultérieurement.
Irrégularités formelles : un DGD mal structuré ou non conforme peut être jugé irrégulier et alimenter des litiges.
Le problème est encore plus délicat lorsque le DGD n’est pas signé par les parties :
Irrégularité du document : sans signature, le DGD perd une grande partie de sa force juridique et devient facilement contestable.
Blocage du DGD tacite : la jurisprudence a rappelé qu’un DGD notifié mais irrégulier (donc sans signature valable) empêche l’entreprise de se prévaloir de la procédure tacite qui, normalement, permet de clore le décompte par le simple silence du maître d’ouvrage.
Perte de sécurité juridique : faute d’un document signé et opposable, chacune des parties peut multiplier les arguments pour contester les montants dus.
Conséquences pratiques : retards de paiement, difficultés de trésorerie et litiges prolongés devant les juridictions administratives ou civiles.
Un DGD fluide se prépare dès la première facture intermédiaire. Mettre en place un tableau de suivi des acomptes, avenants et situations validées permet d’avoir une vision claire et partagée de l’avancement financier. Plus les données sont structurées dès le départ, moins il y aura de zones d’ombre au moment du décompte final.
Il est également recommandé d’impliquer dès le début le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage pour valider une méthode commune de suivi.
Chaque élément contractuel ou technique doit être tracé et archivé. Les procès-verbaux de chantier, ordres de service, avenants signés et comptes rendus constituent la base juridique du dossier.
Ajouter des photographies datées ou des relevés de mesures renforce la valeur probante en cas de litige. Une documentation bien organisée permet non seulement de sécuriser l’entreprise, mais aussi de fluidifier l’analyse par le maître d’œuvre.
Les erreurs de calcul, doublons ou oublis d’acomptes sont parmi les principales causes de blocage.
Avant transmission, un contrôle croisé entre l’entreprise et la maîtrise d’œuvre est indispensable. Comparer les montants cumulés avec le détail des situations précédentes évite les contestations.
L’usage d’un tableau récapitulatif clair, validé à chaque étape, facilite la transparence et limite les écarts d’interprétation.
Un DGD accepté rapidement est le résultat d’un dialogue entretenu tout au long du chantier. Informer régulièrement des écarts de coûts ou des travaux supplémentaires permet d’éviter l’effet de surprise à la fin.
Une communication proactive, avec des échanges formalisés par écrit, instaure un climat de confiance et accélère la validation du décompte. À l’inverse, le silence ou les discussions tardives créent inévitablement des blocages.
Si l’entreprise considère que le DGD transmis n’est pas conforme à la réalité du chantier, elle doit formuler ses réserves dans le délai légal de 30 jours. Passé ce délai, le DGD est réputé accepté et aucune réclamation n’est plus recevable.
Les contestations doivent être précises, argumentées et accompagnées de pièces justificatives. Un courrier clair et documenté démontre le sérieux de la démarche et augmente les chances d’aboutir à une révision.
le DGD n’est pas une facture. C’est un document contractuel qui récapitule et arrête définitivement les comptes entre le maître d’ouvrage et l’entreprise, incluant situations de travaux, acomptes et solde dû.
Le DGD est obligatoire dans les marchés publics et recommandé dans les marchés privés.

Article écrit par Clementine
Simplifiez votre compta avec un expert-comptable à vos côtés
Se faire accompagner

La clause d’inaliénabilité permet de limiter, pour une durée déterminée, la possibilité de céder un bien ou des droits. Utilisée en droit des contrats, en droit des sociétés ou encore dans le cadre des donations et legs, elle répond à des objectifs de protection et de sécurisation.
7 min

Vous voulez transférer rapidement le patrimoine de votre société à son associé unique sans passer par une longue liquidation ? La Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) simplifie cette étape en permettant un transfert automatique de tous les actifs et passifs de l’entreprise.
9 min
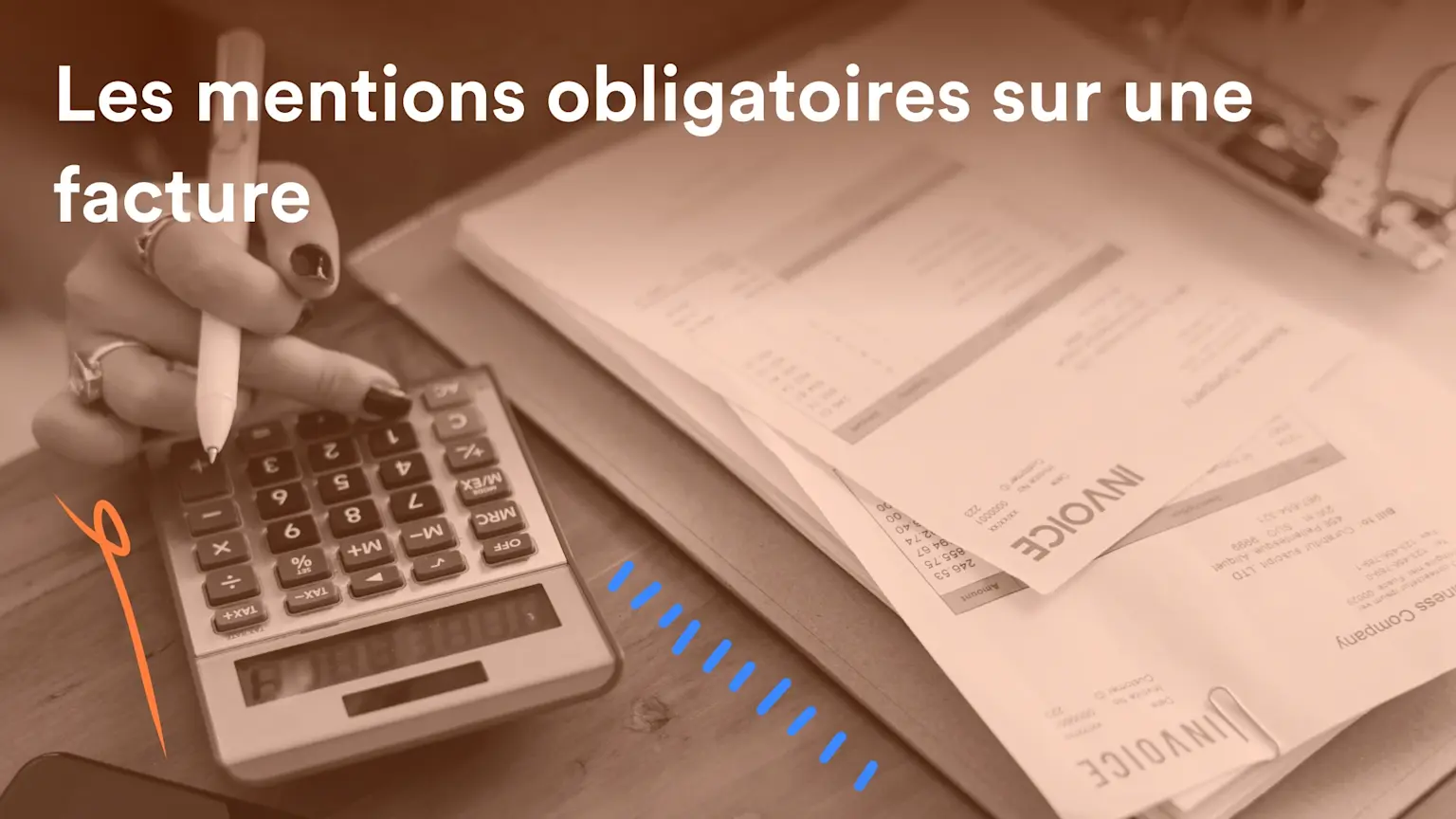
Les mentions obligatoire sur une facture sont essentielles pour que vos documents soient conformes et valables aux yeux de l’administration. Vous pensez peut-être qu’une simple facture suffit, mais un oubli peut entraîner des amendes ou des refus de déduction de TVA.
5 min