Créez votre entreprise gratuitement avec Clementine
Créer mon entreprise
🎁 Offre : Assurance contrôle fiscal à 100 € ⏳ J’en profite

Le Blog de Clementine
Guides, conseils et astuces pour piloter votre activité avec sérénité.
Dernière mise à jour le · 10 min

Résumé de l’article
Le capital social correspond aux apports des associés lors de la création d’une société.
Il sert à répartir les pouvoirs, financer le démarrage et garantir la crédibilité de l’entreprise.
Les apports peuvent être en argent, en biens ou en compétences.
Le montant du capital dépend de la forme juridique et peut aller de 1 € à 37 000 €.
Le dépôt et la libération suivent des règles précises selon le type de société.
Le capital peut être fixe ou variable, et évoluer avec la croissance ou la réorganisation de l’entreprise.
Vous vous demandez à quoi sert vraiment le capital social d’une entreprise ? Est-ce seulement une formalité légale ou un véritable levier stratégique pour la crédibilité, le financement et la gouvernance d’une société ? Ce montant inscrit dans les statuts joue pourtant un rôle important dès la création et tout au long de la vie d’une société.
Dans ce guide, vous découvrirez ce qu’est le capital social, ses fonctions principales, les différents types d’apports possibles, les règles de dépôt et de libération, ainsi que les mécanismes d’augmentation ou de réduction de capital.
Le capital social correspond à la valeur totale des apports effectués par les associés ou actionnaires lors de la constitution d’une société. Ces apports peuvent prendre plusieurs formes (argent, biens, droits...) et, en contrepartie, les apporteurs reçoivent des titres sociaux (parts sociales ou actions selon la forme juridique).
Contrairement à une entreprise individuelle, une société dispose de sa propre personnalité juridique et d’un patrimoine distinct de celui de ses associés. Le capital social symbolise donc la mise à disposition de moyens financiers ou matériels pour permettre à la société de fonctionner.
Le capital social a plusieurs fonctions stratégiques dans la vie d’une entreprise.
Le capital social représente la contribution de chaque associé à la société. Ces apports déterminent directement la répartition des droits dans l’entreprise :
Droits de vote : chaque associé dispose d’un nombre de voix proportionnel à ses parts sociales ou actions, ce qui lui permet d’influencer les décisions stratégiques lors des assemblées générales.
Droits financiers : les dividendes et la quote-part de résultat distribués sont généralement calculés en fonction du pourcentage de capital détenu.
Accès aux organes de décision : un associé majoritaire a un pouvoir de contrôle et peut influencer la gestion, tandis qu’un minoritaire doit souvent s’allier pour peser dans les choix.
Ainsi, la structure du capital social fixe les équilibres de gouvernance au sein de la société et encadre les rapports de force entre associés.
Le capital social constitue la première source de financement de l’entreprise au moment de sa création.
Les apports peuvent être de plusieurs natures (apports en numéraire, en nature ou en industrie). Ils permettent à l’entreprise de financer ses premiers investissements (achat d’outils de production, constitution de stocks, dépôt de brevets, communication...) et d’assurer son fonds de roulement, c’est-à-dire la trésorerie nécessaire pour couvrir ses dépenses courantes (loyers, salaires, charges).
Le capital social joue un rôle important vis-à-vis des partenaires extérieurs :
Pour les banques et investisseurs : un capital élevé rassure, car il montre que les associés ont pris un risque financier personnel et qu’ils croient dans le projet. Cela facilite l’accès au crédit ou à des financements complémentaires.
Pour les fournisseurs : un capital solide constitue une assurance de la solvabilité de l’entreprise, en cas de retards ou de difficultés de paiement.
Pour les clients : notamment dans les secteurs où la confiance est essentielle (construction, services à forte valeur ajoutée), un capital conséquent renforce la crédibilité de la société.
Cependant, il faut noter que dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL, SAS, SA), la responsabilité des associés est limitée à leurs apports. Le capital social est donc le maximum que les créanciers peuvent espérer récupérer en cas de défaillance, sauf faute de gestion ou garanties personnelles des dirigeants.
Au plan comptable, le capital social figure dans les capitaux propres du passif du bilan. Il contribue à donner une image de la santé financière de l’entreprise :
Crédibilité vis-à-vis des tiers : plus le capital est élevé, plus l’entreprise paraît solide et capable de supporter ses engagements.
Structure financière : il représente une partie des fonds propres, aux côtés des réserves et des résultats non distribués. Un capital trop faible peut fragiliser l’image de l’entreprise, voire limiter certaines démarches (par exemple, candidatures à des appels d’offres ou accès à certains marchés).
Effet sur la croissance : un capital plus élevé permet d’absorber des pertes éventuelles sans mettre en danger la continuité de l’exploitation.
Ainsi, le capital social n’est pas seulement une donnée juridique ou comptable. Il constitue un véritable levier stratégique pour renforcer la confiance et assurer la pérennité de l’entreprise.
Le capital social n’est pas uniquement constitué d’argent. Il peut se composer de différents types d’apports.
Les apports en numéraire correspondent aux sommes d’argent versées par les associés. Elles sont déposées sur un compte bloqué au nom de la société en formation (banque, notaire, Caisse des dépôts). Une fois l’immatriculation réalisée et le Kbis obtenu, les fonds sont débloqués et utilisés pour financer l’activité.
Ces apports sont importants pour :
rassurer les partenaires financiers
donner à la société une crédibilité économique
couvrir les premiers investissements et besoins de trésorerie
Les apports en nature sont des biens autres que de l’argent :
Biens corporels : locaux, terrains, matériel, véhicules…
Biens incorporels : brevets, logiciels, marques, clientèle…
Ils peuvent être apportés :
en propriété : la société devient propriétaire du bien
en jouissance : l’associé reste propriétaire mais met le bien à disposition
Lorsque la valeur d’un apport dépasse 30 000 € ou que l’ensemble des apports en nature représente plus de 50 % du capital, un commissaire aux apports doit évaluer les biens. Ce contrôle évite les surévaluations et protège les autres associés.
Les apports en industrie correspondent aux compétences, au savoir-faire ou au réseau qu’un associé met au service de la société. Ils ne forment pas de capital social car ils ne sont pas évaluables en argent, mais ils donnent des droits si les statuts les reconnaissent :
participation aux bénéfices
droit de vote aux assemblées
Quelques exemples :
un développeur qui apporte ses compétences techniques à une startup
un entrepreneur qui met son réseau relationnel à disposition
Ces apports sont souvent déterminants pour le succès d’un projet, même sans investissement financier.
Le montant du capital social varie en fonction de la forme juridique de la société :
SARL, SAS, EURL, SNC : aucun minimum légal, il peut être fixé à 1 € symbolique
SA et SCA : le capital social minimum est de 37 000 €
Certaines activités réglementées (banque, assurance, transport...) exigent des capitaux plus élevés
Comme vu précédemment, un capital trop faible peut poser problème : manque de crédibilité auprès des banques, risque de sous-capitalisation, difficultés fiscales. C’est pourquoi il est recommandé de fixer un capital réaliste et adapté aux besoins du projet (investissements prévus, trésorerie initiale, fonds de roulement, attentes des investisseurs…).
💡 À savoir : même en l’absence de minimum légal, les statuts doivent mentionner précisément le montant du capital social.
Le dépôt du capital social s’effectue auprès d’un établissement habilité à recevoir les fonds : il peut s’agir d’une banque, d’un notaire ou encore de la Caisse des Dépôts et Consignations. Dans la grande majorité des cas, les créateurs d’entreprise choisissent une banque afin d’ouvrir un compte bloqué au nom de la société en formation.
Concrètement, les associés doivent verser les apports en numéraire (chèque, virement ou espèces selon les cas) sur ce compte dédié. Le dépôt est accompagné de plusieurs justificatifs, tels que :
un exemplaire des statuts de la société (ou un projet signé)
la pièce d’identité et un justificatif de domicile des associés
l’adresse du siège social
la liste des souscripteurs et le détail des apports
un justificatif de l’origine des fonds
Une fois le dépôt effectué, l’établissement délivre une attestation de dépôt de capital. Ce document est indispensable pour immatriculer la société auprès du greffe du tribunal de commerce.
Les fonds demeurent bloqués jusqu’à la délivrance du Kbis. Après immatriculation, ils sont libérés et peuvent être utilisés librement par l’entreprise pour financer ses premiers besoins d’exploitation.
Les associés ne sont pas obligés de verser immédiatement la totalité de leurs apports en numéraire.
En fonction du type de société, la part minimale à libérer varie :
SARL et EURL : au moins 20 % du capital social doit être libéré au moment de la création. Le solde peut être versé en plusieurs fois, dans un délai maximum de 5 ans.
SAS et SA : au moins 50 % doit être versé immédiatement, le reste devant être libéré dans le même délai légal de 5 ans.
Par exemple, si vous créez une SARL avec un capital social de 10 000 €, vous devez déposer au minimum 2 000 € à la constitution. Les 8 000 € restants peuvent être versés progressivement, à condition que tout soit libéré dans les cinq ans.
💡 À savoir : tant que le capital n’est pas totalement libéré, certaines sociétés ne peuvent pas bénéficier du taux réduit d’IS à 15 %.
Lors de la création d’une société, les associés doivent fixer le montant du capital social, qui peut être fixe ou variable.
Le capital social fixe, le plus courant, impose une procédure lourde pour toute modification (assemblée générale extraordinaire, modification des statuts, formalités au greffe). Cela assure stabilité et crédibilité auprès des partenaires, mais peut freiner les entreprises en forte évolution.
Le capital social variable, plus souple, prévoit dès l’origine une fourchette entre un capital plancher et un plafond. Les variations à l’intérieur de ces limites ne nécessitent aucune formalité particulière, ce qui facilite l’entrée ou la sortie d’associés et l’adaptation aux besoins de l’activité. En revanche, cette flexibilité peut sembler moins sécurisante aux yeux de certains partenaires financiers.
Au cours de son développement, une entreprise peut être amenée à modifier son capital, soit à la hausse, soit à la baisse, afin de répondre à des exigences financières, à une orientation stratégique ou à certaines contraintes.
L’augmentation de capital consiste à accroître le montant du capital social inscrit dans les statuts. Elle peut intervenir pour diverses raisons : financer une croissance, renforcer la crédibilité de la société, faire entrer de nouveaux investisseurs ou encore rétablir des fonds propres.
Les principales modalités sont :
Par apport en numéraire
Par apport en nature
Par émission de nouvelles parts sociales ou actions : l’entreprise crée de nouveaux titres que peuvent souscrire les associés actuels ou de nouveaux investisseurs. Si les associés existants ne participent pas, leur part est diluée.
Par incorporation de réserves ou de bénéfices : les bénéfices non distribués ou les réserves sont transformés en capital social. Cela ne nécessite pas d’apport extérieur, mais renforce les fonds propres et rassure les partenaires financiers.
La réduction de capital consiste à diminuer le montant du capital social inscrit dans les statuts. Cette opération est souvent plus sensible car elle peut envoyer un signal négatif aux créanciers et partenaires, sauf lorsqu’elle est motivée par une réorganisation.
Les principales situations sont :
Pour absorber des pertes : lorsque la société connaît des difficultés financières, la réduction de capital permet d’assainir la situation en imputant les pertes sur le capital. Cela évite que les capitaux propres deviennent trop inférieurs au capital social.
Pour permettre le retrait d’un associé : un associé qui souhaite quitter la société peut se faire rembourser ses parts sociales. Dans ce cas, le capital social est réduit du montant correspondant.
Dans le cadre d’un « coup d’accordéon » : cette opération consiste à réduire le capital social à zéro pour effacer les pertes, puis à procéder immédiatement à une augmentation de capital. Elle permet de "remettre à plat" la structure financière de l’entreprise et de repartir sur des bases saines.
Augmenter le capital social renforce la crédibilité de la société, améliore son accès au financement, rassure partenaires et clients, permet d’accueillir de nouveaux associés et de soutenir la croissance en apportant de nouvelles ressources financières.
Le capital social est débloqué après l’immatriculation de la société. Une fois le Kbis obtenu, il suffit de le transmettre à la banque ou à l’organisme dépositaire pour que les fonds soient transférés sur le compte professionnel et deviennent utilisables.
Le capital social n’est pas récupérable tant que la société existe. Il ne peut être restitué aux associés qu’en cas de réduction de capital décidée légalement ou lors de la dissolution et liquidation, après paiement des dettes.

Article écrit par Clementine
Créez votre entreprise gratuitement avec Clementine
Créer mon entreprise

Vous avez déjà entendu parler du code NAF d’une entreprise (nomenclature nationale d’activités française), mais savez-vous vraiment à quoi il sert et comment il est attribué ? Dans cet article, nous vous expliquons tout ce qu’il faut savoir sur le code NAF, comment le trouver, le comprendre et, si nécessaire, le corriger.
6 min

Vous exercez dans un secteur saturé ou très compétitif ? Se démarquer est essentiel pour attirer et fidéliser ses clients ! L’avantage concurrentiel est un levier qui offre la possibilité à une entreprise de se distinguer et de renforcer sa position sur le marché.
8 min
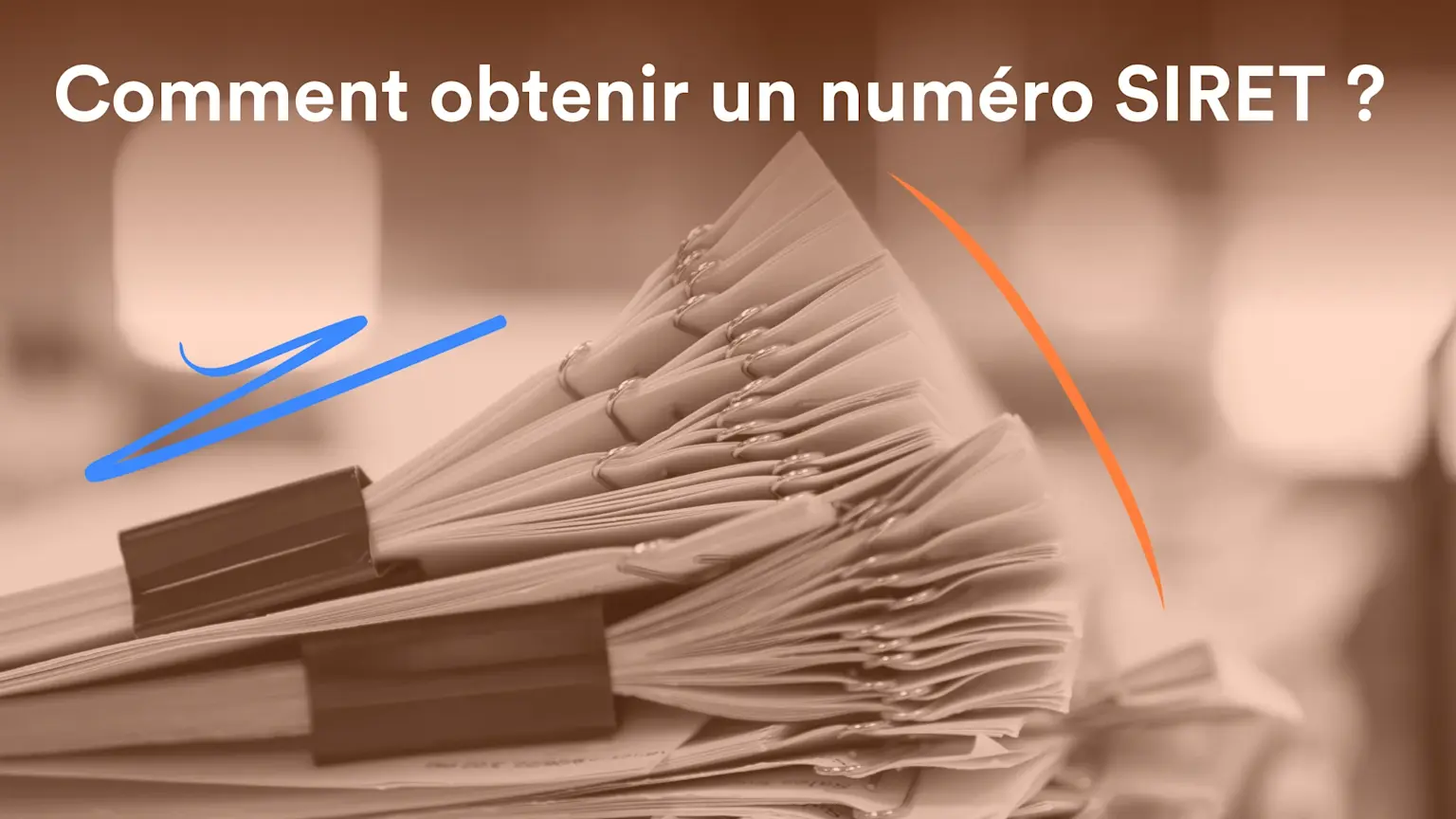
·
Comment obtenir un numéro SIRET ?Vous voulez lancer votre activité rapidement ? Alors il vous faut votre numéro SIRET. Que vous soyez micro-entrepreneur, dirigeant de société ou responsable d’association, ce numéro permet d’identifier votre établissement auprès des administrations et de facturer vos clients en toute légalité.
6 min